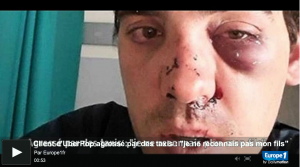Depuis 2 ou 3 ans, les sites de contrats-types en ligne se multiplient pour permettre aux entrepreneurs de créer simplement leur société, de la gérer, d’assurer leurs levées de fonds, etc. Peut-on parler d’un risque d’uberisation du droit et des professions juridiques ? C’est ce qu’explique par exemple cette tribune parue dans Le Monde à ce sujet.
Ce modèle de contrats-types proposés par des outils numériques remonte en fait à la création de Creative Commons par Lawrence Lessig : une série de documents juridiques répondant à un besoin massif lié à un usage nouveau (la diffusion de contenus en ligne), des clauses permettant de s’adapter à la situation particulière de chacun (les contrats CC-By-SA et CC-By par exemple), un système d’aide à la décision permettant de choisir le bon contrat.
Les premiers outils de smart contrats remontent aussi à cette mouvance. Au-delà du texte juridique, Creative Commons a par exemple prévu dès le départ des logos qu’on peut apposer sur son site ou sur ses documents pour les identifier, ainsi que des méta-données qui peuvent être exploitées par des algorithmes ou des machines pour savoir automatiquement quels droits sont reliés à quels documents.
Pour Creative Commons, le résultat a été une fabuleuse explosion du nombre d’oeuvres librement réexploitables et diffusables sur Internet, à commencer par Wikipedia.
Mais le modèle est-t-il donc si aisément transposable à tout le reste ? Creative Commons avait l’avantage de s’appuyer sur une communauté extrêmement dynamique, sur un modèle not-for-profit et sur un besoin clair, identifié, et international.
Quel avenir pour les sites de contrats automatiques qui ne réussiront pas à faire participer leur communauté à leur gouvernance ? Penser qu’il suffit de connecter un système d’aide à la décision avec des documents générés de façon automatique, c’est revenir au Droit Assisté par Ordinateur qui existe depuis les années 70.
La communauté et la démarche sont d’autant plus importants que le coût d’entrée sur le marché est plutôt faible. Le service public propose déjà de très nombreux documents de grande qualité comme des statuts d’association ou d’entreprise. Beaucoup de démarches sont numérisées depuis longtemps comme la création de société, le dépôt de marque ou le pré-dépôt de plainte. Et rien n’est plus facile que de créer un nouveau site web qui saura intelligemment proposer articuler tout cela en proposant quelques services de plus.
Reste la possibilité de s’adosser à un besoin économique solide, comme par exemple les sites de résiliation de contrats d’abonnement qui se multiplient autour de jechange.fr. L’intérêt commercial est évident, mais l’impact ne se fera pas sentir au coeur de l’univers du droit.
En définitive, la question n’est pas tant celle de l’uberisation du droit que son entrée dans un monde ouvert et collaboratif. A quand des contrats écrits à plusieurs mains ? Retravaillés par des communautés ? Des conclusions contentieuses diffusées publiquement pour mieux comprendre les jurisprudences ? Une co-écriture de la loi avec les praticiens qui devront l’appliquer ? Une entrée des avocats au sein des administrations, des ministères et de leurs cabinets ? Une participation du public qui ne se limite pas au commentaire des projets qu’on leur soumet ?
Le problème n’est pas tant de rendre le droit plus technologique, mais de lui faire faire sa révolution culturelle vers plus d’ouverture et de collaboration. On se trompe en pensant que c’est l’innovation technologique qui a fait le succès de AirBNB ou de Uber. Leur réussite vient d’abord de la qualité de leur design, de l’accent mis sur leur culture d’entreprise, de la cohérence de leurs modèles juridiques et économiques.
Les juristes ne sont pas seuls face à ces difficultés. Comprendre l’innovation est devenu le graal de nombreux entrepreneurs, et une question de survie pour échapper à « l’uberisation ». La stratégie est redevenue une compétence-clé. Elle est la seule à permettre à chacun de créer sa différence, à se donner une valeur unique grâce à laquelle le retour sur investissement sera plus important. Contrairement à ce que pensent de nombreux juristes confrontés au numérique, il ne s’agit pas tant d’aplatir les processus existants, mais de réussir à recréer une activité intrinsèquement originale. L’innovation ce n’est pas de supprimer des intermédiaires dans la façon dont on produit et transporte l’électricité, c’est de réussir à réinventer de nouvelles sources d’énergie qui réorganiseront complètement le modèle.
Wikipedia utilise par exemple avec originalité les règles du droit d’auteur pour permettre de construire une encyclopédie collaborative. AirBNB construit un système de logement partagé grâce à des CGV et des CGU intelligemment rédigées pour créer une nouvelle expérience d’hébergement à mi-chemin entre chambres d’hôte et chambres d’hotel. Uber interprete la réglementation des VTC pour proposer un service dont la qualité n’était pas à disposition des consommateurs auparavant. Quoi de plus utile que de créer soi-même les catégories juridiques qui permettront de justifier l’activité nouvelle que vous voulez exercer ?
L’émergence de la problématique des données et le besoin de recruter des data scientists est autre un bon exemple. Dans une approche technologique traditionnelle, le poste concerné serait plutôt celui d’un ingénieur statisticien. Dans une approche stratégique plus moderne comme celle retenue pour Etalab, le poste nouvellement créé d’administrateur général des données a notamment pour vocation de piloter la stratégie de licence des données publiques et leur gouvernance au sein de l’Etat. Et plutôt que de l’aborder en silo comme une fonction qu’il est nécessaire de remplir, il le présente dans une perspective ouverte et participative, invitant de nombreux acteurs extérieurs à venir partager et échanger sur ces élements afin de nourrir leur propre stratégie en retour. Ce sont les propres missions de l’Etat qu’il redéfinit autour de nouvelles hypothèses intellectuelles.
Les juristes qui vivent aujourd’hui la modernisation de leur profession devraient se rappeler que l’uberisation était décrite dès 1950 dans l’une des principales bibles de la Silicon Valley écrite par Norbert Wiener et intitulée “The Human Use of Human Beings”, c’est-à-dire “L’utilisation des êtres humains par d’autres humains” – et non pas “Cybernétique et société” comme le propose timidement la traduction française.
Voilà peut-être le programme qu’il faudrait éviter.
Mais pour cela, il faut rester prudent et réfléchir à une véritable stratégie d’ouverture et de collaboration, plutôt que de s’en remettre trop facilement aux solutions proposées par le mirage technologique.
Alors, à quand une stratégie ouverte et collaborative face aux risques de l’uberisation du droit ?