Update 1 : pour tenir compte des questions sur les réseaux sociaux
Update 2 : pour tenir compte des précisions du contrôleur du Thalys
Update 3 : à propos du CFS obligatoire dans les avions
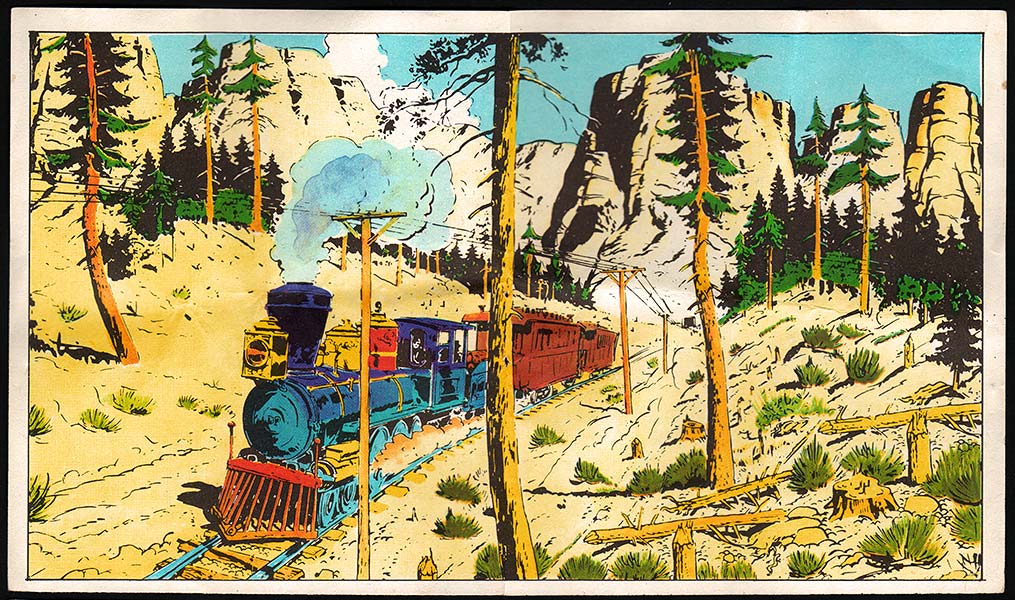
C’est l’acteur Jean-Hugues Anglade qui a mis le feu aux poudres en déclarant à la presse que les agents de Thalys présents à bord du train attaqué avaient laissé tomber les passagers en courant se réfugier dans un compartiment fermé. Un contrôleur aurait bien tenté d’intervenir, mais malgré les demandes insistantes des voyageurs, les autres agents auraient refusé d’ouvrir et de porter assistance aux passagers, y compris à lui-même qui s’était blessé à la main.
Là dessus, de nombreuses interventions sur les réseaux sociaux tentent d’expliquer que leur réaction était normale et que n’importe qui aurait fait de même à leur place. Mais il se trouve que quand on est responsable d’un train qui transporte des centaines de voyageurs, on n’est pas n’importe qui.
Et ça fait un moment puisque que les transporteurs sont tenus à une obligation de sécurité depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1911.
Un voyageur s’était alors fait écraser le pied par un tonneau mal arrimé dans un bateau entre Marseille et Alger. Mesquin, le transporteur s’est montré procédurier en essayant de contester le choix du tribunal algérois devant la Cour de cassation. Mauvaise pioche puisque si la Cour a bien accepté de faire perdre un peu de temps au plaignant en rapatriant son litige, elle en a profité pour décider que quelles que soient les clauses du contrat de transport, le transporteur avait l’obligation de « conduire le voyageur sain et sauf à destination« .
En langage juridique, on dit que le transporteur est tenu d’une « obligation contractuelle de sécurité. »
Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour que cette jurisprudence se répande aux transports ferroviaires alors en pleine expansion, et toujours plus en faveur des passagers puisque la Cour a introduit dans un arrêt de 1913 le terme de « sécurité résultat ». Le transporteur ne peut pas se contenter de mettre en oeuvre des moyens pour acheminer les voyageurs »sain et sauf », il doit réussir à le faire. Un arrêt de la Cour de cassation de 1969 a même précisé où commence et où s’arrête l’obligation de sécurité en précisant que le transporteur doit conduire les passagers sain et sauf « à partir du moment où ils montent dans le véhicule et jusqu’à ce qu’ils en descendent. »
A compter de cette date, l’obligation contractuelle de sécurité devient alors une obligation contractuelle de sécurité « de résultat. »
Mais il ne s’agit jusque là que de couvrir des accidents. L’occasion d’aborder les agressions dans les trains s’est présentée dès 1929 à l’occasion de l’agression d’un passager par un autre dans un tunnel ferroviaire. S’appuyant sur les miracles de l’article 1382 du code civil qui oblige à démontrer une faute pour engager la responsabilité, la Cour a décidé de laisser le transporteur tranquille. Le passager avait bien tenté d’expliquer que le tunnel où il s’était fait agresser n’était pas éclairé, mais s’était révélé incapable de le démontrer. La solution est restée stable, et a même été précisé en 1974 à propos de l’agression de voyageurs par d’autres dans le métro. La Cour a alors écarté la responsabilité de la RATP, en ajoutant que ces événements n’étaient « ni prévisibles ni évitables« , c’est-à-dire qu’ils constituaient un fait de force majeure donc le transporteur ne pouvait être tenu responsable.
Pourquoi favoriser ainsi le transporteur ? Parce que l’obligation de sécurité est considérée comme seulement complémentaire à l’obligation de déplacement. L’objectif social est d’abord de faciliter la vie des transporteurs pour leur permettre de développer leur activité. Les responsabiliser à outrance les contraindraient à complexifier leurs activités, à embaucher de la sécurité supplémentaire, etc. Bref, ca n’irait pas dans le sens de la France du TGV, du RER du métro. Ce qui compte, c’est le transport, pas la sécurité.
Sauf qu’avec le temps, les événements dramatiques se multiplient : des rixes, mais aussi carrément des viols et des meurtres. Difficile de continuer à expliquer que les agressions ne sont « ni prévisibles, ni évitables » quand elles se succèdent de façon régulière d’années en années.
En 2000, les choses évoluent et la Cour décide que la station Châtelet n’est pas le Far West, et que la SNCF n’est pas le Pony Express. Un passager agressé et blessé entre Marseille et Paris reproche à la SNCF un manque de surveillance du train.
D’un point de vue juridique, la Cour décide alors d’intégrer ce qu’on appelle « le risque-agression« dans le champ de la donc fameuse « obligation contractuelle de sécurité de résultat. »
En 2002, la Cour confirme cette orientation à propos d’une jeune femme, passagère d’un train Genève – Nice qui avait été menacée d’un couteau, blessée et dépouillée de ses bijoux. L’argumentation est on ne peut plus claire : « les agressions ne sont pas imprévisibles et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière, revêt-elle un effet dissuasif. »
A compter de cette date, ca y’est, on peut commencer à dire que le transporteur devient responsable des agressions subis par ses voyageurs.
Le principe est d’ailleurs confirmé par un règlement européen du 23 octobre 2007 qui précise bien que les compagnies ferroviaires ont bel et bien le devoir d’assurer la sécurité personnelle des voyageurs.
Il reste cependant encore une exception décidée par la Cour en 2011 qui a refusé de reconnaître la responsabilité du transporteur à propos d’un voyageur qui en avait poignardé un autre de façon « irrationnelle« , c’est-à-dire sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale.
Alors qu’en penser par rapport à l’affaire du Thalys ?
Si on résume, les transporteurs sont tenus d’une « obligation-sécurité » à l’égard de leurs voyageurs. Ils ne peuvent s’en exonérer qu’à condition que l’acte ait été irrationnel. Expliquer que les agressions sont imprévisibles ne suffit pas. Il relève de leur responsabilité d’analyser le risque en fonction du contexte, et donc notamment en fonction du contexte de risque terroriste plus élevé que la moyenne.
A moins d’expliquer que l’irruption d’un énième acte terroriste sur le sol européen soit un acte « irrationnel » et « imprévisible » – mais comment l’accepter dès lors que le terroriste avait visiblement soigneusement préparé son coup, il semblerait donc bien que Thalys soit responsable et qu’ils auraient du relever leur niveau de sécurité en conséquence.
En ce qui concerne les événements, le témoignage de Jean-Hugues Anglade concorde pour l’instant avec celui de Anthony Sandler pour dire que les responsables du train se sont enfuis sans informer, ni assister, ni secourir les passagers. Leur comportement est peut-être humain et excusable – bien que triste, mais il engage certainement leur entreprise.
La directrice de la communication de Thalys est dans son rôle quand elle conteste la version de Jean-Hugues Anglade, mais est-il vraiment normal d’avoir si peu d’agents dans un train international de 500 personnes ? Est-il normal que la procédure suivie par les agents choque quasiment tous ceux qui ont lu les descriptions des témoins ?
Les technos détestent être pris en faute, et Guillaume Pepy a beau jeu de dire que « la vérité de M. Anglade n’est peut être pas la seule« , mais est-ce que le comportement de ses agents ne relève pas d’abord d’un manque de formation, de moyens ou d’encadrement – et donc de son fait ? Tient-il vraiment à soutenir que le meilleur moyen d’assurer la sécurité de ses passagers était de s’enfermer dans une cabine fermé et d’y rester ?
Quelles que soient les excuses qu’on puisse leur trouver, il sera sans doute compliqué pour Thalys et la SNCF, son actionnaire principal, de s’exonérer de leur responsabilité. A la fois en ce qui concerne la survenance d’un attentat terroriste évité par miracle dans leur train, et en ce qui concerne le comportement de leurs agents à cette occasion.
Tout en gardant à l’esprit que le terroriste est le principal responsable de cette situation, il reste quand même à savoir ce que ces deux entreprises comptent faire pour éviter que ça se reproduise.
PS : pour ceux qui souhaiteraient prendre connaissance des conditions générales de vente de Thalys, elles sont ici
PPS : petit détail sordide, si la réglementation ne prévoit pas vraiment comment réagir en cas d’agressions, elle précise très bien qui indemnise qui en cas de décès
Update 1 : Beaucoup de gens ont l’impression qu’il s’agit de remettre en cause de pauvres hôtesses apeurées qui auraient été dépassées par la situation car elles n’étaient de toute façon là que pour servir le café… mais il ne s’agit pas tant de mettre en cause le personnel que l’entreprise. Comment se fait-il par exemple que le transporteur ne dispose que de deux serveuses pour encadrer 500 voyageurs et faire face à tous les problèmes qui peuvent se poser pendant les quelques heures de voyage ? En réalité, on apprend que, dans les Thalys, « l’équipage est constitué d’un à 3 chefs de bord ainsi que de 2 à 4 hôtesses et stewards suivant les remplissages du train. » Est-ce qu’ils étaient formés à cette situation ? Est-ce qu’ils disposaient de procédures à suivre ? Quelles étaient ces procédures ? Est-il normal de ne pas informer les passagers ? Etc. Dans tous les cas, c’est sur l’entreprise que pèse l’obligation de sécurité dont il est question ici.
Update 2 : Le point de vue d’un des contrôleurs est rapporté par France Info. Il donne une meilleure image du personnel de bord, mais reste un peu étonnant, notamment en ce qu’il est complètement contradictoire avec les témoignages précédents. Ceci dit, c’est peut-être normal que toutes les témoignages soient un peu désorganisés quand on a été victimes d’une telle violence. Et ça ne change rien sur la question de la responsabilité de Thalys et de la SNCF.
Update 3 : On me signale que dans les avions, les personnels navigants (hôtesses de l’air et stewards) ne peuvent exercer que s’ils détiennent le diplôme d’état du Certificat de formation à la Sécurité (CFS) dans lequel on trouve notamment des éléments liés à la sûreté, à la communication, à la gestion des passagers, des entrainements en situation concrète, etc. Je ne sais pas s’il existe un équivalent pour le ferroviaire, ni à quel personnel il s’applique.
